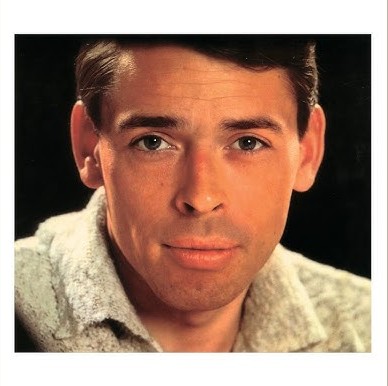Initialement, cette chanson enregistrée en 1962 devait figurer sur le sixième album studio de Jacques Brel. Mais le hasard a voulu qu’au même moment, le réalisateur François Leterrier préparait l’adaptation au cinéma du roman de Jean Giono « Un roi sans divertissement ». Quand il a demandé à une chanson pour son film à Jacques Brel, celui-ci a immédiatement compris qu’elle illustrerait les thématiques du roman de façon parfaite: il l’a donc écartée de son album à paraître, et elle figure dans la bande originale du film qui sort en salle en 1963.
Le roman de Giono décrit un anti-héros à ce point pris par une angoisse existentielle, à ce point englué dans un invincible ennui, à ce point incapable de trouver le repos, qu’il en vient à chercher le divertissement, l’excitation ou la distraction dans des occupations qui lui font de plus en plus abandonner son humanité (la chasse, la torture, le meurtre…). Cet homme traverse sa vie tel un zombie morne et hagard, et il y sème le malheur.
Le roman de Giono décrit cette trajectoire de désolation de façon impressionnante, mais la chanson de Jacques Brel y ajoute, à mon avis, une touche encore plus émouvante de mélancolie et de poésie. Sans doute parce qu’elle décrit l’ennui non pas comme la tare d’un individu quelconque (le capitaine Langlois), mais comme l’une des expériences les plus universelles qui soit: les humains, peut-être les hommes plus que les femmes d’ailleurs, me semble-t-il, passent une grande partie de leur vie à se demander ce qu’ils font sur terre et à quoi va servir leur vie, à se perdre dans des souvenirs plus ou moins heureux, à ruminer sur leurs échecs et leurs mauvaises décisions, à rêvasser sur ce qui pourrait leur permettre de trouver un peu de paix, et au moins, par pitié, de moins s’ennuyer. « Pourquoi faut-il que les hommes s’ennuient? » Le titre même de la chanson décrit cette expérience comme une sorte de malédiction à laquelle personne ne peut échapper.
Le résultat de cette incapacité à sortir de l’ennui, c’est bien entendu le fait de gâcher sa vie, et c’est ce que le texte de Jacques Brel évoque de façon si percutante et bienveillante à la fois. Une succession d’images évoquent ce qu’il y a déjà de bon dans la vie des hommes (les hôtesses sont douces, le vin fait tourner manège…), et tout ce dont ils pourraient encore profiter (« Pourtant il nous reste à rêver / Pourtant il nous reste à savoir« , « Tous ces printemps qu’il reste à boire« ), tout ce qui fait que la vie recèle encore bien des mystères à découvrir (« Il nous reste à être étonnés« ). Mais le plus souvent les hommes en sont incapables, pour leur malheur: à force de s’ennuyer et de passer à côté de sa vie, « Bon an mal an on ne vit qu’une heure« .
Ce texte désespérant est souligné par un accompagnement encore plus décharné et solennel: quelques arpèges de guitare sèche, et c’est tout. Façon peut-être de souligner qu’en musique comme pour le reste, il suffit de peu de chose pour produire de la beauté, et que ce serait une bonne idée de s’en souvenir un peu plus souvent, pour se désoler un peu moins et se réjouir un peu plus.
« Pourtant il nous reste à tricher,
être le pique et jouer le cœur,
être la peur et rejouer,
être le diable et jouer fleur »