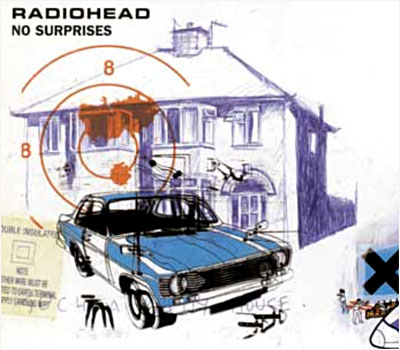Aujourd’hui je me lâche: Radiohead est pour moi le meilleur groupe de rock du monde universel et intersidéral.
Voilà, c’est dit.
Ce n’est pas forcément celui que j’écoute le plus souvent, ni avec toujours le plus de plaisir (c’est autre chose), mais pour moi c’est le plus grand, et ce pour deux raisons au moins.
La première, c’est que Radiohead concentre une quantité dingue d’inventivité, d’originalité et de diversité dans ses compositions. La quasi totalité des groupes (ou des artistes individuels) ne font que baliser des territoires musicaux qui ont déjà été découverts, repasser par des chemins qui ont déjà été tracés, « revisiter » et redécorer des bâtiments qui ont déjà été construits, parfois il y a parfois bien longtemps déjà.
Beaucoup plus ambitieux et novateur, Radiohead explore et défriche des territoires nouveaux, ouvre à la serpe de nouveaux sentiers, monte de nouveaux murs avec de nouveaux matériaux.
Sur « OK Computer » par exemple (pour moi LE plus grand album DU plus grand groupe, c’est dire à quelle hauteur je le place), figure un morceau de six minutes et vingt-trois secondes intitulé « Paranoïd android » , qui est en fait un époustouflant kaléidoscope de plusieurs chansons différentes, et dans lequel on entend à peu près tout ce qu’on peut faire avec une guitare électrique (du doux, du pêchu, du torturé, du déchaîné, avec de brusques transitions de l’un à l’autre…). Les Inrocks ont parlé à l’époque de « Bohemian rhapsody en camisole » .
« OK computer » , c’est aussi les riffs de guitare électrique et les soubresauts synthétiques d' »Airbag » , la mélodie bancale et troublante de « Let down » , le lyrisme enflammé de « Exit Music (for a film) » , l’intro géniale et les sonorités stratosphériques de « Subterranean Homesick Alien » , les nappes de synthé pinkfloydiennes de « Lucky » , etc., etc. Les douze chansons de cet album offrent autant de dosages variés entre guitares et machines (ou entre rock indé et rock progressif), autant de témoignages d’une liberté et d’une audace stupéfiantes. « OK computer » est pour moi le sommet (le trône) vers lequel convergent les expérimentations du rock et des musiques électroniques.
Quant aux textes de Radiohead, ils sont eux aussi d’une grande richesse – je l’ai déjà évoqué à propos de « Karma police » , et on va voir qu’il y a aussi énormément à dire à propos de « No surprises » .
La musicalité, le sens de la mélodie, la poésie, l’ambition et la clairvoyance sur le plan intellectuel (« OK computer » est une prophétie apocalyptique dont on voit clairement qu’elle est en train de se réaliser), tout cela place le groupe très, très loin au-dessus non seulement du tout venant, mais même des autres « bons groupes » .
La deuxième raison pour laquelle Radiohead est pour moi le plus grand groupe de rock, c’est que cette recherche artistique (musicale et littéraire) va de pair avec une capacité à produire des mélodies simples, évidentes, imparables, et qui peuvent plaire très largement. Je vénère littéralement les derniers albums de Talk Talk, mais il faut bien reconnaître qu’il y a énormément de gens à qui ça ne parle pas (trop long, trop lent, trop étrange: « De quoi ça parle ? Où est le refrain ? Mais quel est donc ce son bizarre ? »). Talk Talk est un groupe qui occupe une petite niche musicale, alors que Radiohead réussit ce prodige d’être formidable sur le plan artistique, et en même temps d’être accessible pour quasiment n’importe qui, au moins sur certaines compositions… comme « No surprises » , justement, qui a reçu un accueil critique enthousiaste et qui a été en tête des charts en Angleterre et aux USA.
Voilà déjà pour le groupe.

Quant à la chanson de ce soir, « No surprises » , c’est un joyau absolu, à tel point que si j’étais musicien, j’aurais envie de me mettre à genoux pour obtenir l’inspiration nécessaire à la création d’un morceau d’un tel niveau.
Musicalement, l’orchestration est pleine de sobriété et de tact: un glockenspiel qui nous ancre dans les oreilles, dès les premières notes, une mélodie éthérée, une batterie assourdie, une guitare pour donner de l’impulsion et du rythme, et c’est tout. La preuve par l’exemple que le secret de la beauté et de l’émotion se trouve très souvent dans la simplicité et l’économie de moyens.
La chanson a été enregistrée en une seule prise, sur un tempo qui a ensuite été légèrement ralenti pour donner à la voix un effet plus traînant, plus mélancolique, plus accablé. Au cinéma, la réalisation peut transmettre des émotions ou des idées sans le moindre dialogue, simplement par la mise en scène, les cadrages ou le montage: de la même manière, Thom Yorke et sa bande venue d’Oxford sont maîtres dans l’art de suggérer des choses sans le moindre mot, juste par la recherche d’un certain effet sonore (de même que le magnifique ostinato de « Videotape » signifie le côté routinier et machinal de la vie moderne).
L’originalité de « No surprises » , c’est le contraste frappant et troublant entre la mélodie, d’une beauté splendide, d’une simplicité paisible et enfantine (on pourrait la prendre pour une comptine), et les paroles, sombres et poignantes. « No alarms and no surprises, please » , « Get me out of here« : c’est d’une imploration qu’il s’agit.
« No surprises » est une chanson d’anticipation, une sorte d’épisode musical de « Black Mirror » , qui décrit le quotidien d’un individu lambda dans une société froide et hostile, bétonnée et asphaltée de tous côtés, gangrenée par la technique, l’intelligence artificielle et le virtuel. La nôtre, dans une certaine mesure, et plus sûrement encore, celle vers laquelle le capitalisme high-tech nous entraîne.
Dans cette société, les individus sont maintenus dans un style de vie confortable où le plaisir est fourni avant tout par la consommation, où l’inattendu n’existe plus (« No surprises« ) , où la vie entière est sous contrôle, maîtrisée par des règles, des procédures, des protocoles, des logiciels et des dispositifs techniques. Tout peut y être calculé, quantifié, comparé, benchmarké, et donc anticipé, circonscrit, planifié. Les besoins et les désirs sont identifiés, scrutés, objectivés, afin que la méga-machine se mette en branle pour les combler en proposant de nouveaux objets et de nouveaux services, toujours plus sophistiqués, toujours plus performants. Tout est fait pour créer de la frustration et pour y répondre sur le champ, enfermant ainsi les individus dans la tyrannie de la consommation.
Ce que décrit cette chanson, c’est une société aseptisée, vidée de toute possibilité de rencontre, d’étonnement et d’émerveillement.
Une société inhumaine, dans laquelle les coeurs sont gavés et débordent comme des décharges (« a heart that’s full up like a landfill« ).
Une société dans laquelle nos vies sont désincarnées et dévitalisées, dans laquelle nous sommes des pantins qui répondent à des stimuli, tous en même temps (se lever, prendre le métro, travailler, faire ses courses, partir en vacances ou en week-end, fêter la nouvelle année…).
Une société dans laquelle le travail a de moins en moins de sens, dans laquelle les bullshits jobs deviennent presque la norme (« A job that slowly kills you« ).
Une société dans laquelle même l’univers privé n’est plus synonyme d’intimité et de ressourcement, dans laquelle le loisir n’est plus une occasion de s’accomplir (comme dans l’otium des romains), mais au contraire nous conduit à nous abrutir plus encore devant des écrans.
Une société dans laquelle l’amour est absent même là où il devrait être le plus ardent et réconfortant, à savoir dans la cellule familiale (là encore ce sont souvent l’ennui et l’amertume qui dominent).
Une société dans laquelle la nature n’est plus une source de contemplation et d’émerveillement, mais un espace à exploiter, à domestiquer et à dompter – même la pelouse doit être propre et nette.

Ce que chante Radiohead dans « No surprises » , c’est ce que la société moderne fait de nous: des individus qui font des efforts pour se vendre en présentant leur meilleur profil, qui à première vue semblent épanouis et dynamiques, mais qui en réalité sont profondément malheureux (« You look so tired, unhappy« ) – ou pire encore des individus éteints, creux, sans âme, morts de l’intérieur, vidés de tout élan vital et de toute spiritualité. La magnifique pochette du single me fait penser à « Mon oncle » de Jacques Tati: elle montre une jolie maison et une belle voiture, mais comme l’a dit son créateur Stanley Donwood, « c’est horriblement triste. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un à la maison. »
Certains ont vu dans ce texte un éloge du suicide comme la solution ultime: « This is my final fit / my final bellyache » . De fait, il y a dans « No surprises » une atmosphère de résignation assez terrible (« Bruises that won’t heal« ) , rendue justement plus poignante par le côté tranquille et mélodieux de la musique.
Mais Thom Yorke a toujours récusé cette interprétation, et on peut en effet entrevoir une dimension plus lumineuse dans ce morceau. Derrière la plainte, derrière l’angoisse d’être submergé et englouti par la folie de la technique, des métropoles, de la communication numérique et de la mondialisation, derrière l’envie de se recroqueviller sur une petite vie peinarde et sans surprise dans un pavillon banlieusard, il y a aussi, en tous cas il peut y avoir un vif désir d’une vie plus simple, plus sobre, plus apaisée, mais aussi plus vibrante et intense. D’une vie où nous serions moins « connectés » à des objets et à des technologies, mais plus et mieux reliés à des individus, à des coeurs, à des êtres de chair et de sang (humains et non humains), à des paysages, à des œuvres… à tout ce qui fait la richesse et la beauté tragique de l’existence.
La dualité du morceau apparaît de façon subtile mais évidente lorsqu’on regarde le clip. Celui-ci montre un gros plan fixe du visage de Thom Yorke en train de chanter. À partir de 1’17, après un léger noir, sa tête est enfermée dans un casque de cosmonaute ou un bocal de poisson rouge qui se remplit petit à petit d’eau. Thom Yorke redresse la tête pour continuer à respirer, puis son visage est déformé par l’angoisse et la douleur lorsque l’eau recouvre ses narines… Soudain le bocal se vide brusquement, et il recommence alors à chanter, pour évoquer un lieu dans lequel on pourrait enfin mener une vie tranquille et heureuse (« Such a pretty house / and such a pretty garden« ).
Ce clip assez malaisant expose les deux temps de la chanson et de la réflexion: la société moderne nous écrase et nous cantonne dans des vies d’autant plus épuisantes qu’elles sont vides de sens, mais nous n’y sommes pas totalement condamnés.
Il est possible d’en sortir par le suicide, qui peut en effet apparaître comme une solution lorsqu’on est à bout.
Mais le soulagement peut aussi venir lorsqu’on décide que ça suffit, qu’on ne veut plus jouer ces règles du jeu, que l’on ne veut plus contribuer au désastre intime et global, que l’on ne veut plus peut-être un rouage anonyme d’une immense machine mortifère, et qu’on veut au contraire être du côté de la vie, du coeur, du lien, de la respiration. De la rencontre, aussi – et de la surprise.
« No surprises » est une chanson sur le sommeil et sur le réveil. Ou bien sur l’enfermement (« 1984 » d’Orwell) et la libération par la pensée et l’imaginaire (les scènes finales de « Brazil » sur les collines verdoyantes).
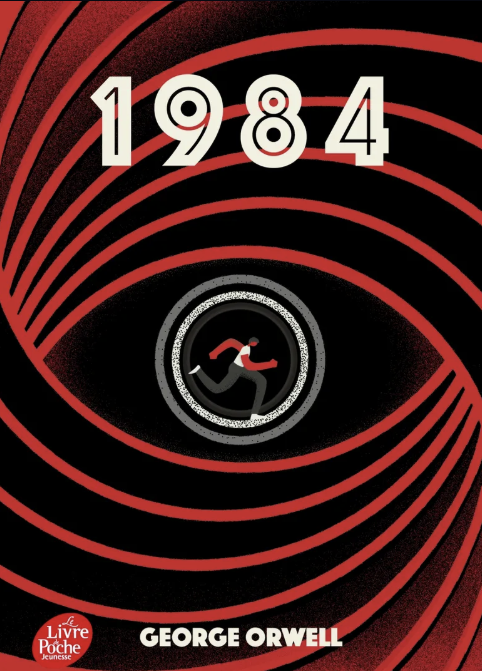
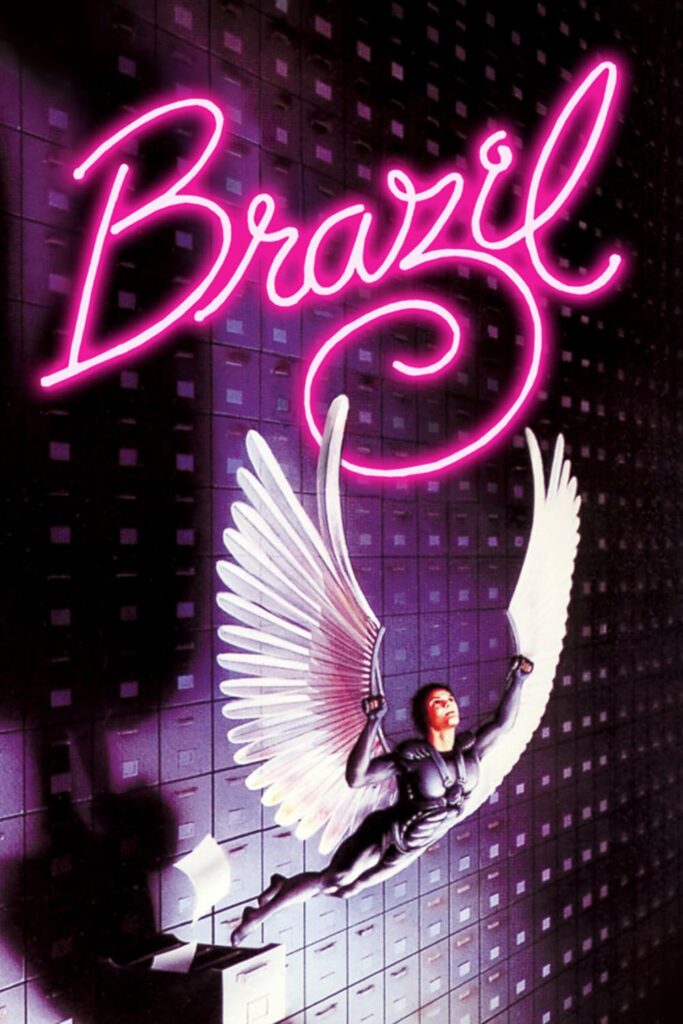
Le sommeil, c’est là où nous sommes, maintenus sous sédatif par la société industrielle, qui a besoin de nous comme producteurs et comme consommateurs.
Le réveil, c’est la décision que nous pouvons prendre de lâcher prise, de bifurquer, de changer de vie, de partir un peu à l’aventure (intérieure et extérieure), et de voir ce que ça peut donner.
S’il en fallait encore une de plus, il y a une dernière raison pour laquelle j’adore « No surprises »: cette chanson apparaît en fond sonore dans une très belle scène de « L’auberge espagnole » , le film générationnel de Cédric Klapisch. Dans cette scène, le jeune étudiant joué par Romain Duris, allongé dans la minuscule chambre qu’il occupe dans une colocation barcelonaise, médite avec mélancolie, les yeux rivés sur le plafond.
J’aime beaucoup ce film, et mon garçon Dorian plus encore, car il y voit une description enchantée de ce qu’il a vécu dans sa première coloc étudiante à Amiens. Il est aussi fan de Radiohead et de « No surprises » , comme moi. Puisque cette chanson est un des nombreux goûts que nous avons en commun, c’est une raison supplémentaire de l’aimer avec passion.
« Such a pretty house,
and such a pretty garden »