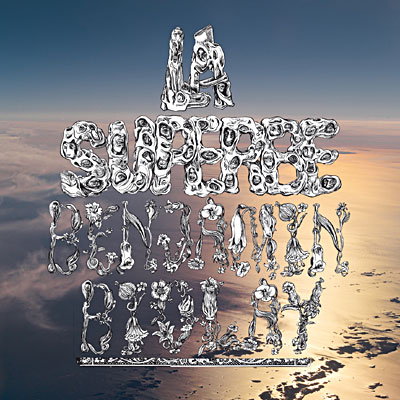Puisque j’ai partagé tout à l’heure un texte de Milan Kundera qui parle de la recherche du regard de l’autre, je me suis dit que ce serait une bonne idée de la compléter avec cette chronique musicale, que j’ai déjà rédigée depuis longtemps (j’en plus de 200 en stock, ça se voit que j’aime écrire…).
« On reconnaît les grands disques au fait qu’ils sont obligatoirement des reflets de nous dans la glace. Nos ombres de l’autre coté du miroir. » (Pierre Derensy)
De ce point de vue, il y autant de « grands disques » que d’auditeurs et d’auditrices, puisque tout le monde a ses propres reflets dans la glace, ses propres ombres de l’autre côté du miroir, ses propres fêlures toujours prêtes à craquer à la moindre source d’inquiétude, ses propres angoisses, ses propres sources de joie…
Cinquième album solo de Benjamin Biolay, « La superbe », fait partie de mes « grands disques » à moi, car j’y retrouve tant de mes obsessions et de mes difficultés: le chagrin inconsolable d’avoir échoué dans ce qui était l’une des deux principales priorités de ma vie, à savoir réussir ma vie de couple (« Brandt rhapsodie »); l’inquiétude chevillée au corps de ne pas être le papa que mes enfants méritent et de ne pas réussir à leur transmettre ce dont ils ont besoin pour être heureux (« Ton héritage »); la tentation souvent invincible pour le spleen et la mélancolie (« La superbe »); musicalement, le goût pour les compositions et les arrangements pleins de subtilité et de classe…
« Padam » fait partie de ces chansons dans lesquelles Benjamin Biolay, toujours aussi impressionnant d’audace et d’honnêteté, se met à nu et se décrit en homme vaincu par ses addictions, par son incapacité à se sentir pleinement relié aux humains qui l’entourent, par son besoin irrépressible de compréhension et d’amour, et par sa conviction maladive que ceux-ci ne lui seront jamais vraiment accordés, comme s’il était prisonnier d’une sorte de malédiction.
Il fut un temps où il avait si honte de ce qu’il était qu’il n’osait pas en parler (« Si souvent, j’ai gardé pour moi mes vicissitudes et mes vices, / et tourments, tournis, turpitudes« ). Sans doute la honte, ce poison vicieux, est-elle toujours présente, instillée dans tout son corps, mais au moins il a trouvé quelque part le courage pour parler humblement de ses travers, pour se présenter en homme imparfait, comme nous le sommes toutes et tous.
Pendant longtemps, Benjamin Biolay a essayé de lutter contre les tourments qui l’assaillent par ce que les psychothérapeutes appellent des « stratégies d’adaptation dysfonctionnelles », à savoir des tentatives désespérées pour lutter contre nos vieux schémas destructeurs, ou pour faire comme s’ils n’existaient pas, ou pour s’y vautrer de façon compulsive afin de mieux les confirmer… « Souvent, je me suis pris pour un autre et j’ai fait des doubles fautes, / double sec, double dose, double dame avec les femmes d’un autre« .
Le résultat de tout cela, ce n’est pas seulement une longue succession d’échecs, mais carrément un dépôt de bilan (« Long est le chemin qui mène / à la faillite en presque tous les domaines« ) – et quand on connaît l’histoire de sa famille (ses parents et grands-parents ont connu une inexorable descension sociale), le choix du mot « faillite » est ici particulièrement significatif. Benjamin Biolay est contre lui-même un enquêteur inlassable, un procureur impitoyable – son propre pire ennemi.
Dans cet océan de confessions sombres et peu flatteuses, il y en a une qui revient quatre fois dans les refrains et qui me touche profondément, car elle dit de façon terrible et poignante que quand on n’a pas appris à s’aimer de façon sincère, bienveillante et tendre, alors on est plus ou moins condamné à être dépendant du regard des autres: « J’attendais en vain / que le monde entier m’acclame, / qu’il me déclare sa flamme« .
Cette soumission au jugement d’autrui, aux critiques mais aussi aux félicitations (on le remarque moins, mais je connais quelques incorrigibles vantards qui feraient bien d’y réfléchir…), c’est peut-être l’une des pires geôles qui soit, et tous les thérapeutes savent qu’elle est très difficile à extirper du coeur de celles et ceux qui en sont affligés.
Mais le fait d’en parler, ouvertement, sans fard ni enjolivures, en prenant le risque du qu’en dira-t-on ou du ridicule, c’est sûrement le premier pas indispensable pour se libérer de cette prison. C’est aussi pour cela, finalement, que cette chanson me touche tant. « Padam » décrit un univers intérieur dévasté, et du même mouvement elle indique la seule issue possible: s’accorder assez d’importance pour s’assumer tel que l’on est, que cela plaise ou non. Se donner à soi-même la preuve que l’on est une personne de valeur, dont les états d’âme sont légitimes et méritent d’être divulgués. Se donner à soi-même la preuve qu’il n’y a pas de honte à être ce que l’on est. Dans cette chanson, Biolay le fait avec courage et avec superbe, et c’est l’une des raisons pour lesquelles il m’est si précieux.