« Innamoramento ».
Ce substantif italien sensualissime désigne l’état que l’on ressent au moment où une petite voix intérieure et des sensations délicieuses nous chuchotent que l’on est en train de tomber amoureux. Autrement, pourquoi donc éprouverait-on cette impatience à recevoir un message, et cette excitation à en découvrir le contenu?
À ce stade ce n’est pas l’amour, pas encore. Mais c’est déjà une étincelle, c’est déjà un avant-goût de bonheur, même si celui-ci est encore teinté de crainte et de réserve (« Et si l’autre ne m’aimait pas autant que moi? Et si ça ne se passait pas entre nous comme je l’espère? Et si, et si, et si? » ).
En français il n’existe pas de substantif équivalent à l’innamoramento. Dans notre langue on peut « s’énamourer », on peut « être énamouré », mais on ne peut pas dire « l’énamouration » ou « l’enamourement » .
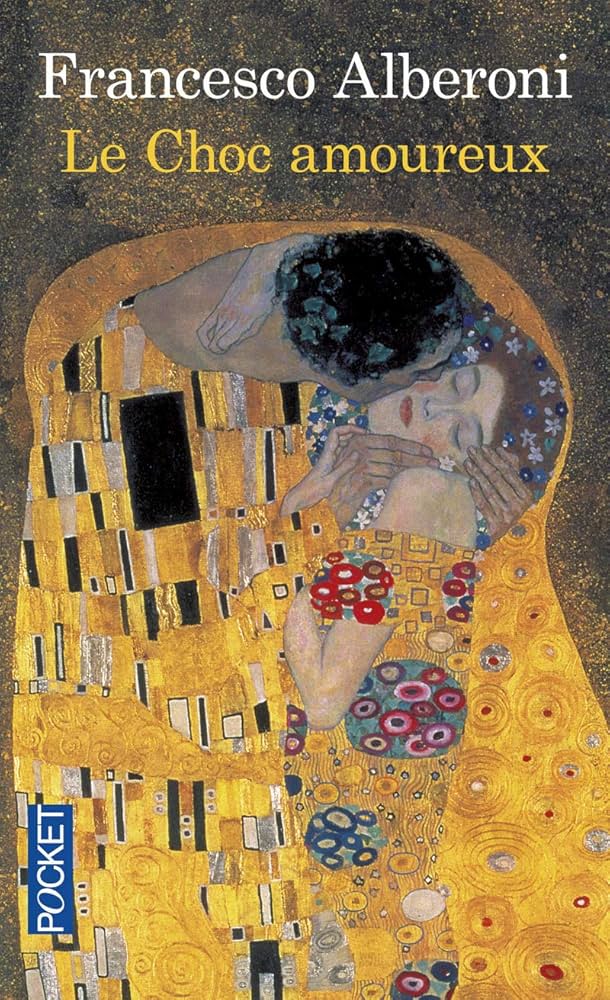
Pourtant comme le note la philosophe Olivia Gazalé dans son livre Je t’aime à la philo, une expression similaire existait dans la langue d’Oc (« adamare »), mais elle est tombée en désuétude lors de la répression de l’hérésie cathare. « C’est pourquoi les traductrices du beau livre de Francesco Alberoni, « Innamoramento e amore », ont opté pour les expressions « choc amoureux », « état naissant de l’amour » ou encore « amour naissant », pour qualifier cet état hypnotique des débuts » .
L’innamoramento, c’est peut-être le moment où la chose la plus sage à faire est de fermer les yeux et de lâcher les freins.
Mais nous vivons une drôle de période où des relations peuvent se nouer à distance, devenir très fortes et tendres, susciter une impression d’évidence, sans que jamais on se soit vu, et encore moins touché, respiré… Sans qu’on sache ce que l’autre « dégage » par son apparence physique mais aussi par sa voix, sa gestuelle, sa façon de marcher, d’évoluer dans l’espace, de rire… Est-ce que cette autre correspondra à l’idée que je m’en fais, est-ce que je correspondrai à l’idée qu’elle se fait de moi? Est-ce que nos corps s’accorderont et vibreront l’un avec l’autre? Est-ce qu’il y aura de la place pour l’un dans le monde de l’autre, et vice-versa? Et si, et si, et si?
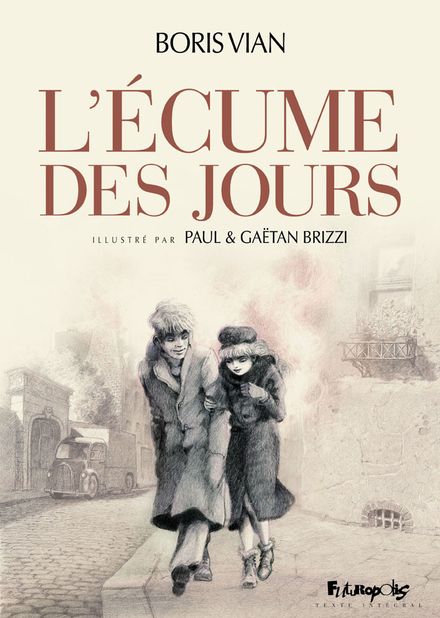
C’est alors qu’intervient la rencontre, merveilleusement décrite par Roland Barthes: « Une découverte progressive […] des affinités, complicités et intimités que je vais pouvoir entretenir éternellement […] avec un autre, en passe de devenir, dès lors, «mon autre» . »
Dans L’écume des jours de Boris Vian (un roman lu dans mes jeunes années, l’un de ceux que j’ai le plus adorés), lorsque Colin rencontre Chloé, saurait-il expliquer pourquoi « à l’intérieur du thorax, ça lui faisait comme une musique militaire allemande, où l’on n’entend que la grosse caisse » , ou pourquoi « sa bouche lui faisait comme du gratouillis de beignets brûlés » ? Pas sûr. Et si c’est déjà difficile dans la « vraie » vie de décortiquer et de mettre des mots sur ce qui se passe en nous, que dire lorsque les premiers échanges ont eu lieu sur Internet?
