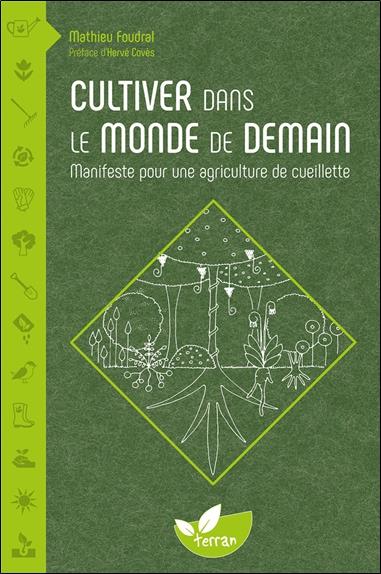Bilan d’un week-end prolongé de travail au jardin. Rien qu’en trois jours, j’ai passé exactement 15 heures dehors pour repiquer très exactement 153 pieds de légumes : des tomates anciennes (ananas, rose de Berne, Marmande, noire de Crimée, cœur de bœuf rouge, tomates cerises), des melons kazakhs, des pastèques, des patates douces, des concombres, des courges et des courgettes. J’ai aussi semé 2 kilos de semence de pommes de terre. 15 heures pour désherber ou ameublir le sol à genoux les mains dans la terre, pour remplir et déplacer des brouettes de compost, pour remplir et vider des arrosoirs… Voilà un aperçu de ce que ça donne.
J’imagine que certain·es vont peut-être s’étonner de voir des photos de terre à nu, puisque comme on dit en permaculture, « il faut imiter la nature » , et dans la nature un sol laissé en libre évolution est presque toujours recouvert (en tous cas dans un biotope comme le mien). C’est aussi le principe du maraîchage sur sol vivant (MSV) : on apporte régulièrement de la matière vivante au sol, mais on n’y touche pas et on ne le retourne pas.
Quand j’ai commencé à jardiner, il y a une petite dizaine d’années, j’ai essayé d’appliquer ces préceptes à la lettre, mais je dois dire que j’en suis un peu revenu. Plus précisément, j’essaye de les appliquer, mais pas de façon totalement systématique et dogmatique, conformément à ce que j’écrivais dans mon livre sur la permaculture : « Les principes de la permaculture ne sont pas des dogmes. Ils ne doivent pas être suivis et mis en œuvre de façon aveugle ou mécanique, mais toujours en fonction du contexte. De toutes façons il ne peut pas en être autrement, car comme on aura l’occasion de voir dans ce chapitre, ces principes peuvent parfois se contredire, en tous cas se nuancer et se tempérer mutuellement : dès lors, un principe pourra prendre le pas sur un autre dans une situation, alors que ce sera plutôt l’inverse dans un autre contexte… »
Cet hiver, en dehors des zones qui restent en culture (cf. plus bas), j’ai intégralement paillé le sol de mon potager à partir du mois d’octobre, avec l’herbe que j’avais débroussaillée autour de la maison et dans le verger, et ce de façon très généreuse (partout une épaisseur d’une quinzaine de centimètres). Le paillage est vraiment une excellente solution, à la fois pour freiner la repousse des adventices indésirables au printemps, et plus encore pour maintenir la fraîcheur du sol en été.
MAIS au printemps, le paillage a quand même trois inconvénients au potager.
1) Il freine la repousse des adventices indésirables, mais il ne la stoppe pas, en tous cas pas autant qu’une bâche totalement opaque. En particulier, le liseron n’est guère dérangé par le paillage, il passe à travers, et quand on le voit apparaître il a déjà fait des racines puissantes et profondes.
2) Plus ennuyeux, le paillage ralentit le réchauffement du sol, or il y a beaucoup de plantes qui ont besoin d’un minimum de chaleur pour se développer (ou pour que leurs graines puissent germer, ce qui est par exemple le cas du haricot).
3) Surtout, le paillage est l’une des meilleures techniques d’élevage de limaces qu’on puisse imaginer : elles ont à la fois le gîte et le couvert (un abri vis-à-vis du soleil et des prédateurs, et une masse de végétation en décomposition dont elles sont très friandes). Quand on soulève le paillage au printemps, il y en a de partout… et en plus on sait qu’elles ont pondu des tonnes d’oeufs. L’année dernière à la même époque, avec les pluies du printemps, mon jardin ressemblait à un embouteillage de limaces et d’escargots (la photo ci-contre a été réalisée sans trucage, je n’ai pas déplacé une seule limace, j’ai simplement choisi le cadrage le plus impressionnant). Inutile de dire que quand on en est à ce stage de « submersion » (coucou François B.), repiquer en écartant un peu le couvert végétal est un projet à peu près aussi saugrenu et voué à l’échec que d’essayer de faire admettre à un chroniqueur de CNews que l’effondrement écologique en cours est un poil plus grave et angoissant que le déclin des « valeurs chrétiennes de la France » .
>> Pour ces différentes raisons, je fais le choix d’enlever le paillage en milieu de printemps, quand je vois que la météo annonce plusieurs jours de temps ensoleillé et chaud. Dans la foulée, j’ameublis le sol sur la surface nécessaire pour installer les plants que j’ai à repiquer et/ou pour les semis que je prévois de faire.
Ameublir, ça veut dire greliner, puis casser les mottes, émietter grossièrement la terre, et au passage enlever les adventices, avec le plus possible de racines de liseron. C’est donc un travail du sol, certes, et qui est assez intensif, mais qui reste quand même assez superficiel. Tout cela se fait à genoux, et c’est crevant. Mais ça me permet d’avoir un sol net, et d’éloigner les limaces car elles n’apprécient pas ces terrains découverts et escarpés.
//////
Je précise quand même que la surface que je « nettoie » en la mettant à nu et en ameublissant et émiettant la terre est modeste, et que ce n’est absolument pas un désert minéral vidé de toute vie animale sur des dizaines de m2:
– Je n’ai pas une mais cinq zones de potager, séparées les unes des autres par des bandes herbeuses assez larges et / ou par de nombreux arbustes et petits fruitiers (cassissiers, framboisiers, myrtilliers, camérisiers, amélanchiers, feijoa…), et même par des arbres fruitiers (deux cerisiers, un pommier, des pêchers de vigne…). Et tout autour du potager, la végétation est à peu près intacte en cette période: arbres (fruitiers ou non), glycine, herbes folles, bandes fleuries, nombreux petits fruits, etc. L’une des caractéristiques essentielles du « jardinage permaculturel » ou inspiré par la permaculture, c’est le fait qu’il se fait sur de petites zones qui sont elles-mêmes insérées au milieu de zones écologiquement préservées, lesquelles constituent autant de réserves à auxiliaires (insectes, petits mammifères, lézards, couleuvres, crapauds…)
– A l’intérieur du portager proprement dit, même dans cette période de préparation du sol, certaines zones restent en culture: par exemple j’ai plusieurs rhubarbes, quatre zones de fraisiers, de l’ail, du fenouil perpétuel, et cinq énormes cardons qui continuent à faire de l’ombre, à maintenir le sol frais et à abriter des bestioles diverses (dont mes magnifiques lézards verts).
J’ai aussi laissé par ci par là cinq ou six pieds de blettes, quelques poireaux, ainsi que des crucifères qui sont montées en fleurs (des choux kale red russian, de la moutarde red giant, du mizuna…).
Enfin de nombreux plants spontanés d’arroche rouge poussent un peu partout. Je laisse aussi pousser les plants de pommes de terre qui ressortent spontanément à partir de tubercules oubliés (cf. la photo ci-contre, en arrière-plan derrière un plan de pastèque). Il y a même déjà des fleurs (par exemple de la bourrache, de l’euphorbe épurge…).
Tout ceci est une autre caractéristique importante du « jardinage permaculturel »: il utilise beaucoup de plantes dites « vivaces » ou « pérennes » (ou a minima des plantes qui se ressèment toutes seules).
>> Autrement dit, même lorsque j’ai désherbé, ameubli et émietté le sol, bien souvent je repique mes plants au milieu de plantes déjà bien installées – comme ci-dessus pour le plan de melon au milieu des fraises, ou le plan de pastèque à côté d’un pied de pommes de terre.
– Je précise aussi que je ne nettoie les zones à cultiver qu’au fur et à mesure. Actuellement par exemple, il reste plusieurs zones très denses de mâche qui avait grainé à la fin du printemps dernier, et que je laisse grainer à nouveau (sauf là où je souhaite cultiver tout de suite, dans ce cas j’arrache et j’utilise en paillage).
– Enfin, le paillage que je retire, ainsi que les herbes et les racines que j’arrache, je les dépose sur le tracé des futurs chemins à l’intérieur de chaque zone du potager. Ainsi il reste des espèces de « corridors écologique » à bestioles (qui constituent aussi des refuges pour les limaces, mais bon, il n’y a pas de solution miracle à tous les problèmes à la fois).
>> Bref, même pendant cette période de travail du sol, il continue à y avoir beaucoup de vie dans mon jardin potager. Les photos ci-dessous donnent une idée de ce que ça donne une fois que j’ai nettoyé et préparé le sol sur les zones que je veux mettre en culture, avant semis ou repiquage: on est quand même assez loin de l’anéantissement biologique et de la destruction du sol.




//////
Une fois que le sol est prêt et que c’est l’heure de planter ou de semer…
– Pour le semis, j’écarte des sillons que je referme délicatement en émiettant entre mes paumes de la terre humide après avoir déposé les graines de carottes, de radis, de betteraves, de panais… Ou bien je sème à la volée sur une petite surface (0,5 ou 1 m2) du mizuna, de la moutarde red giant, de la coriandre, du persil, etc., puis je « plombe » au râteau (en n’appuyant pas trop car mon sol est assez lourd et commpact), je maintiens humide jusqu’à la levée (ça peut prendre trois semaines pour les ombellifères telles que les carottes ou le persil), et après la levée j’éclaircis si besoin.
– Pour les repiquages, je creuse des trous d’une vingtaine de centimètres de large, j’y balance une pelletée de compost mûr que je mélange avec la terre ameublie, j’installe mon plant, et j’arrose généreusement pour limiter le stress pour les racines fragiles (les jours suivants, la terre juste autour du pied est bien plus sombre qu’entre les pieds, signe que la fraîcheur et l’humidité est encore là). Je repique plutôt le matin que le soir, justement pour que l’humidité n’attire pas trop les limaces pendant la nuit.
Quelques temps plus tard, une fois que je suis sûr que les pieds ont bien repris et ont commencé à se développer, une fois qu’ils ont assez grossi pour ne plus être appétissants pour les limaces, je remets le paillage, généreusement, pour le reste de l’été.
Voilà ma technique pour le repiquage (ou le semis).
//////
Bien sûr, tout cela exige beaucoup d’énergie. S’il y a une chose que j’ai appris depuis que je vis ici et que je m’occupe régulièrement de mon jardin, de mon verger et de mon terrain, c’est que ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail que ce que j’imaginais, et que ce que la plupart des écolos citadin·es imaginent (et encore, je ne produis qu’une petite fraction de ma nourriture, et je ne dois pas m’occuper d’animaux au quotidien !) J’avoue que si une grande partie de ces cultures foirent, je serai assez dégoûté en pensant à tout le travail que j’ai fourni au préalable.
Je sais aussi que sur le plan énergétique, le maraîchage est d’un rendement assez faible par rapport à ce que mon ami Mathieu Foudral appelle « l’agriculture de cueillette » . Sur le plan écologique et énergétique, il est bien préférable de laisser se développer des légumes vivaces ou qui se ressèment tout seuls (cardons, mâche…), ou de planter des arbres fruitiers, ou de manger des plantes sauvages comestibles. Ça je le fais aussi, plus ou moins. Mais il se trouve que pour l’instant, mes arbres fruitiers sont encore jeunes (notamment mes noyers). Quant aux légumes frais (sauvages ou non), c’est savoureux, ça fournit énormément de vitamines et de minéraux, mais c’est plein d’eau et ça ne nourrit pas son homme : si je veux récolter des calories, de quoi caler l’estomac et faire fonctionner le moteur, les orties et le plantain ne suffiront pas, il faut bien que je cultive certains légumes comme des pommes de terre ou des patates douces.
//////
A propos des pommes de terre, j’entends déjà les conseils du type « Mais pourquoi tu ne fais pas de patates sous foin ? » La réponse est simple: je m’en méfie, parce que si j’ai beaucoup lu et entendu que c’est génial, j’ai aussi recueilli plusieurs témoignages disant que sous la paille, les tubercules sont plus vulnérables aux campagnols (un voisin m’a expliqué que la quasi totalité de sa récolte a été bouffée ainsi…) Or des campagnols, il y en a pas mal dans mon jardin (et ils s’en donnent à cœur joie contre les patates douces). L’an dernier, j’ai testé les deux méthodes de production pour les pommes de terre :
– la traditionnelle et éreintante (creuser des trous, déposer les germes, recouvrir…),
– la deuxième perma-compatible et plus économe en énergie (déposer des germes de pommes de terre à même le sol nettoyé, et balancer dessus non pas du foin mais du compost bien mûr).
De fait, la deuxième a donné des résultats assez épatants. Mais avant de mettre tous mes œufs dans le même panier, j’attends de pouvoir observer pendant plusieurs années comment ça se passe, et si la deuxième technique me paraît meilleure dans la durée, il est probable que je l’adopterai de plus en plus.
– Il y a une troisième technique de culture de patates que j’aime bien utiliser, et qui est très simple : il suffit… d’oublier des tubercules au moment de la récolte ! L’année suivante, si tout va bien, s’il n’y a pas de gel tardif, on se retrouve avec des pieds déjà très développés au moment où on sème les plants, et on récolte précocement des pommes de terre nouvelles, sans avoir rien fait (cf. la photo du plant de pastèque plus haut).
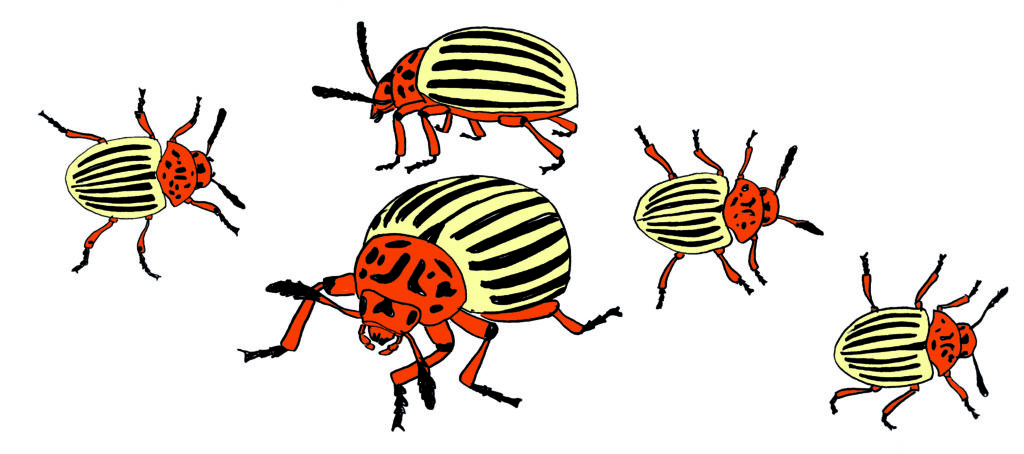
[Avec cette technique il faut quand même faire gaffe aux ravageurs spécifiques des solanacées, notamment le fameux doryphore, qui peut passer l’hiver et ressurgir au même endroit et qui peut faire de gros dégâts si on ne contrôle pas sa présence.
//////
Très honnêtement, je ne crois plus aux méthodes miraculeuses, qui seraient adaptables, pleinement efficaces contre tous les problèmes (les limaces, les altises, les pucerons, la sécheresse du sol, l’épuisement du sol, etc.), et qui totalement dénuées du moindre inconvénient, et ce dans tous les contextes. Par exemple, il est important d’enrichir le sol en compost bien mûr… mais un sol très riche favorise la prolifération du liseron. Autre exemple: pour lutter contre les attaques d’altises, l’un des meilleurs moyens est de maintenir un environnement très sec… mais si le sol est déjà sec et dur en profondeur et si on est en période de semis ou repiquages, les légumes vont un peu faire la gueule si on les prive d’eau. Quant aux problèmes posés par le paillage, j’en ai déjà parlé. Bref, pas de solution miracle à tout… ce qui veut dire qu’on en est réduit à bricoler avec les différentes solutions qui nous sont disponibles, en fonction de notre contexte, de la météo, de notre sol, de nos objectifs de culture, de l’environnement (certaines techniques marchent très bien dans un environnement préservé mais pas du tout au milieu de parcelles de jardins familiaux tenues par des affolés du Roundup et des granulés à limaces…)
>> Comme je dis toujours dans mes conférences ou mes formations sur la permaculture, la phrase la plus utile et la plus souvent utilisée en permaculture, c’est « Ça dépend ». Une technique pourra marcher de façon formidable une année et foirer l’année suivante, parce que le contexte aura changé (météo, présence plus ou moins marquée de ravageurs et/ou d’auxiliaires…)
Dans MON contexte, CETTE année, je peux me permettre d’utiliser des techniques de jardinage assez « traditionnelles ».
– Je suis encore pas totalement décati, je peux encore fournir ce boulot, mais « la terre est basse », et quand ça deviendra trop dur pour moi, j’envisagerai sans doute avec plus de faveur d’autres techniques moins crevantes.
– J’ai la chance d’avoir un accès à peu près illimité à l’eau, en tous cas au printemps (un abreuvoir qui coule bien, et une réserve en béton de 20.000 litres alimentée avec l’eau de pluie qui tombe sur la toiture des granges), donc je sais qu’une fois que mes plants seront bien installés, je pourrai sans problème arroser très largement toutes les zones de potager avant de les pailler à nouveau : ainsi l’humidité descendra en profondeur, et le paillage permettra de la préserver comme si je l’avais toujours laissé.
Mais si l’année prochaine mon accès à l’eau est fortement restreint, ou si on a déjà à la mi-mai un sol extrêmement sec et dur, bien sûr que j’envisagerai de simplement écarter le paillage pour installer les plants de tomates, de concombres ou de courges. En pleine sécheresse printanière, retirer partout le paillage serait destructeur pour le sol. Simplement si j’avais fait ça l’année dernière, avec le printemps pluvieux qu’on a eu et l’invasion de limaces qu’il y avait dans mon jardin, je crois que pas un seul de mes plants n’aurait résisté.
Encore une fois, tout est affaire de contexte. Je n’ai pas la science infuse, je lis, j’écoute et j’observe, quand je me plante j’en prends note, et j’en tiens compte.
//////
Soit dit en passant (1), quand je me plante je ne m’en cache pas, contrairement à la plupart des influenceurs potagers, qui ne diffusent à leur followers que des photos magnifiques et des chiffres impressionnants, mais pas ce qui a foiré. Pour ma part je préfère l’honnêteté au marketing: il m’arrive assez souvent d’avoir des résultats faiblards, voire misérables (par exemple avec les patates douces, dont les campagnols raffolent, si bien que les tubercules sont souvent creusés quand je les récolte).
Soit dit en passant (2), ces influenceurs potagers vantards ont aussi tendance à passer sous silence le fait qu’ils ont en général un sol plus ou moins parfait, un super climat et un accès aisé à l’eau. Ce n’est pas parce qu’on a des récoltes mirifiques qu’on peut faire le malin : tout n’est pas dû QUE au savoir et au travail. Personnellement, je sais qu’en tant que jardinier je pourrais faire bien mieux, et je sais aussi que mes résultats sont largement dus au fait que j’ai la chance d’avoir un excellent contexte (un sol riche, profond et assez neutre, une bonne exposition, et autant d’eau que je veux). Il y a plein de jardiniers et de jardinières qui récoltent moins que moi, parce que leur contexte est nettement moins favorable – mais si ça se trouve ils ou elles maîtrisent bien mieux que moi les techniques de jardinage, et si ça se trouve à leur place je n’arriverais pas à récolter quoi que ce soit de valable.
Le jardinage est quand même une belle école d’humilité : même si on fait de son mieux, c’est en grande partie la nature qui décide.
Voilà, vous savez à peu près tout. Je vais croiser les doigts pour que la météo soit favorable, je vais contribuer à beaucoup bosser au jardin (désherbage, arrosage, taille des tomates, récoltes, conserves…). Et je ferai le bilan à la fin de l’été.