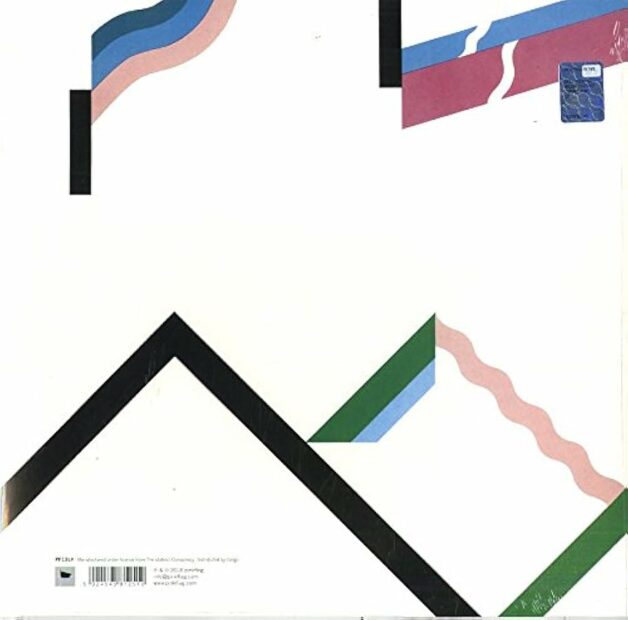Si vous êtes fan à la fois de punk et new-wave, vous connaissez sans doute le groupe anglais Wire, qui est l’un de ceux, avec Joy division notamment, à avoir fait le transition entre ces ceux mouvements musicaux très importants dans l’histoire de la musique populaire.
Fondé en 1976 par quatre étudiants en art de la banlieue de Londres, Wire est à ses débuts un groupe punk, mais très vite il va ajouter à l’énergie brute de ce courant une recherche de sonorités plus riches, plus complexes, plus structurées, plus soignées même, et donc éloignées de la musique un peu mal dégrossie de ses tout débuts.
C’est notamment le cas dans le troisième album de Wire, qui s’intitule « 154 » parce que, paraît-il, c’est le nombre de concerts que le groupe avait donné lorsque ce disque est sorti en 1979. Quoi qu’il en soit, en seulement trois ans Wire a beaucoup évolué, et ses membres sont assez expérimentés et sûrs d’eux pour oser se lancer dans des expérimentations sonores, notamment en intégrant à leur musique les claviers et les synthétiseurs (ce qui était plutôt rare dans le mouvement punk), mais aussi le violon, et même le hautbois et le cor anglais (ce qui est carrément aux antipodes des coiffes à l’iroquoise et des épingles à nourrice dans les narines ou les lobes d’oreille). On note aussi une forte présence de choeurs, un chant de Colin Newman qui scande et qui flirte parfois avec le parlé-chanté… Les guitares ne sont pas pour autant oubliées, mais elles sont plus saturées et dissonantes, leurs sonorités sont moins rêches, moins « sales » et moins agressives que chez beaucoup de groupes punk, et la réverbération est presque permanente. Wire installe ainsi un paysage musical tendu, étouffant, dans lequel l’émotion la plus envahissante n’est plus tant la colère ou la révolte que la noirceur poisseuse, la claustrophobie, l’angoisse oppressante, gluante et physiquement intolérable. En cela la musique du groupe n’est plus vraiment du punk mais plutôt du post-punk, et cela ouvre la voie vers la new-wave, ou vers la cold-wave de The Cure par exemple (je finis toujours par y revenir!), notamment celle de l’album « Pornography ».
Première chanson de cet album, qu’elle ouvre tambour battant, « I should have known better » est particulièrement représentative de cette évolution de Wire vers une musique sombre et torturée, nerveuse mais froide et même glaciale, à l’instar de la voix du bassiste Graham Lewis, profonde, grave mais distante.
Ce titre, que l’on pourrait traduire par « J’aurais du m’y attendre », « J’aurais du m’en douter », ou peut-être même « J’aurais du me méfier », décrit ce qui traverse la tête d’un homme aux prises avec une insomnie alors qu’il est allongé à côté de sa compagne, avec qui il vient d’avoir une vive dispute, et qui rumine en pensant à son couple qui, il le sent bien, est en train de se désagréger, aussi sûrement qu’un morceau de sucre plongé dans l’eau chaude se met à fondre et s’écroule sur lui-même, sans aucune rémission possible.
Mais contrairement au Robert Smith qui a écrit et chanté « Pornography », les membres de Wire ne se complaisent pas dans le malaise ou l’horreur. Le mal-être qu’exprime cette chanson n’a rien de fascinant, au contraire elle le décrit en exprimant aussi des regrets – d’ailleurs les premiers mots sont « In an act of contrition, / I lay down by your side » .
Cela dit ces regrets sont-ils sincères, ou sont-ils de pure forme ? « I should have known better » garde l’émotion à distance, elle la décortique comme on analyse un sujet de philo, sans donner l’impression de s’investir affectivement (« May I make an observation » ). C’est une chanson qui, me semble-t-il, illustre bien la froideur affective qui caractérise les gens que la théorie de l’attachement appelle « anxieux évitants ». Mais la prouesse de Wire est de rendre cela d’une façon si troublante et si impressionnante – disons le, d’une façon si émouvante, justement.
La version demo, plus nerveuse, plus sèche, plus rock, est tout aussi saisissante et excellente, on croirait un enregistrement perdu d’une session des Pixies: