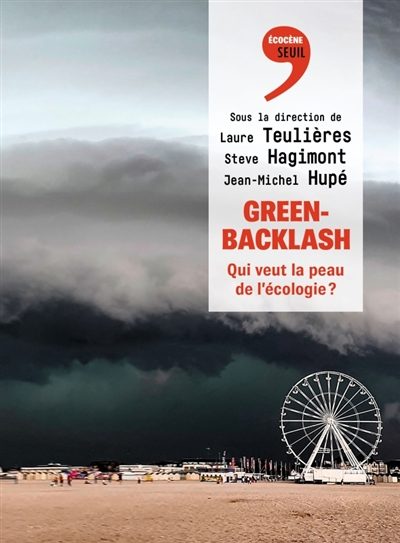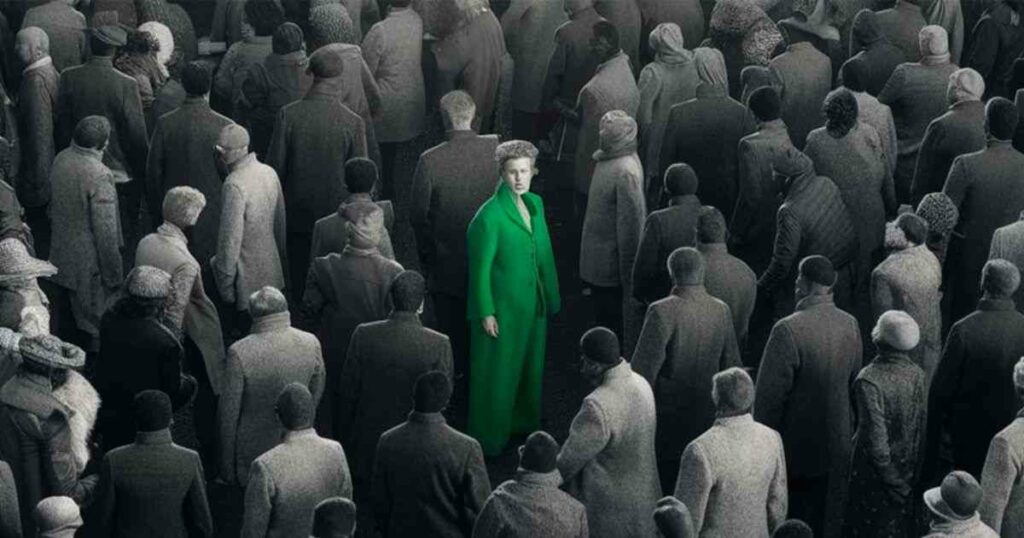À l’origine, le concept de backlash a été inventé par les féministes pour désigner le contrecoup qui pèse sur les droits des femmes après chaque avancée. Ces dernières années, ce concept est aussi appliqué à l’écologie. Un livre collectif est paru sur le sujet le mois dernier aux éditions Seuil (Greenbacklash. Qui veut la peau de l’écologie ?, 320 pages, 23 euros), et la brève recension qu’en fait Claire Legros dans Le Monde me donne envie de le lire.
>> Résumé et commentaire de l’article, et du livre ⤵️
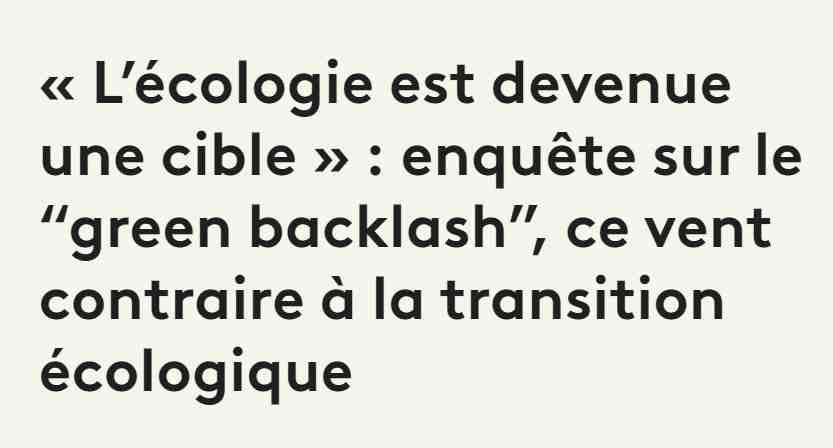
De façon a priori contre-intuitive, plus la destruction du monde est documentée, plus ses manifestations sont évidentes et spectaculaires (y compris aux yeux du grand public), plus les frontières écologiques sont franchies, plus les coûts des dégâts environnementaux sont immenses, et plus « la répression des défenseurs de l’environnement s’intensifie, de même que le détricotage institutionnel de politiques de régulation environnementales, en Europe comme aux États-Unis.«
Il est important de bien mesurer qu’il ne s’agit pas d’une crise conjoncturelle ou d’un recul transitoire : la mise en cause de l’engagement écologique sous toutes ses formes et des politiques environnementales est « un mouvement profond porté par des groupes d’intérêt économiques puissants, et qui se renforce à mesure que la catastrophe écologique s’accélère et que l’urgence d’agir ne fait plus de doute. »
Comme le démontre l’historienne Laure Teulières, maîtresse de conférence à l’Université de Toulouse, qui a codirigé l’ouvrage, la résistance à la transformation écologique des économies et des sociétés occidentales est très ancienne. Elle s’est déployée dès les premières réponses institutionnelles aux constats scientifiques sur la crise écologique, dans le but de les retarder, de les fragiliser ou de les dévoyer – très prosaïquement, dans le but de lutter contre « ces mesures qui viennent contrecarrer [les] intérêts propres » des groupes d’intérêt pétroliers et industriels. Mais au fil des décennies, les stratégies de ces ennemis de l’écologie se sont durcies, en se calquant sur les techniques de communication et de manipulation de l’opinion publique et des dirigeants politique qui avaient été bien rodées par les lobbys cigarettiers.
– Dans un premier temps, on va « instiller le doute dans les esprits par de fausses controverses scientifiques, ou en disqualifiant les lanceurs d’alerte par un discours de dénigrement. »
– Dans un deuxième temps, « lorsque le déni n’est plus possible face à l’évidence des catastrophes« , on passe à « l’enfumage et les fausses promesses des solutions insuffisantes ou trompeuses (le greenwashing), associés à la dénonciation d’une écologie dite « punitive », présentée comme un repoussoir. S’y ajoute le lobbying en faveur de réponses technologiques aux crises environnementales, quitte à réserver ces solutions aux plus riches. »
Dans tous les cas, ‘l’objectif est de brouiller les pistes, afin d’empêcher un débat public sur l’incompatibilité d’une organisation sociale fondée sur une croissance illimitée avec une planète aux ressources limitées, et la recherche de nouvelles voies possibles. » Comme l’écrit Jean-Baptiste Fressoz, auteur d’un des articles de ce livre, « les ennemis de l’écologie – qu’ils soient populistes ou néolibéraux – ne sont que la face visible et grimaçante d’une force colossale, celle qui se trouve derrière l’anthropocène : non seulement le capitalisme, mais tout le monde matériel tel qu’il s’est constitué depuis deux siècles. »
Autrement dit, et là c’est moi qui parle, c’est la société industrielle qui résiste à sa propre remise en cause, et elle le fait de toutes les manières possibles : en tournant en ridicule celles et ceux qui s’affolent et qui s’engagent en faveur de l’écologie, en semant le doute sur la qualité des travaux scientifiques qui objectivent de façon pourtant incontestable la crise écologique, en berçant le public et les élites politiques et économiques d’illusions sur l’efficacité et sur la faisabilité des « solutions technologiques »…
Bref, la « contre-offensive anti-écologique » n’est pas un épisode conjoncturel, elle est une réaction ancienne et systématique des organisations et des individus qui refusent d’être remis en cause et restreints par l’action publique environnementale.
Mais depuis quelques années, à mesure que les effets dramatiques de l’effondrement écologique en cours s’amplifient, la violence de cette contre-offensive anti-écologique redouble : « Les politiques environnementales sont désormais accusées d’être à l’origine des crises, et les défenseurs de l’environnement criminalisés comme des terroristes » . Selon Laure Teulières, « un cran a été franchi« , notamment parce que le backlash écologique est désormais porté au sommet par le président de la première puissance mondiale Donald Trump et par les dirigeants des multinationales les plus puissantes (notamment dans le pétrole et la tech). Les intérêts financiers mobilisés dans la guerre contre l’écologie se diversifient, et ils sont renforcés par les enjeux géopolitiques, les entreprises et les États rivalisant pour s’approprier les ressources nécessaires à la transition et au leadership technologique, notamment en matière d’intelligence artificielle. Comme l’écrit encore Laure Teulières, on a donc désormais une combinaison entre « des mécanismes économiques, sociaux et géopolitiques » de plus en plus diversifiés et imbriqués, tout cela dans le contexte d’une dérive idéologique réactionnaire.
Il s’agit donc bien d’un backlash, et l’utilisation de ce terme emprunté aux études féministes est bel et bien pertinente : dans les deux cas, aussi bien dans les luttes féministes que dans l’écologie politique, l’enjeu est de « [remettre] en cause l’organisation même des sociétés et leur système de valeurs.«
L’article de Claire Legros se termine par une note d’espoir en rappelant qu’un peu partout dans le monde, les citoyennes et les citoyens restent majoritairement sensibles à l’impératif d’une transformation écologique des sociétés et des modèles économiques, à condition que la transition soit juste et accompagnée, et même si cela suppose un cadre plus contraignant et un coût. » Loin d’un ras-le-bol citoyen, le backlash écologique reste avant tout celui d’une minorité aux pouvoirs démesurés. »
J’aimerais être aussi optimiste. En réalité je suis de plus en plus persuadé que parmi les personnes qui se déclarent favorables à la transition écologique juste et qui se disent prêtes à en payer une partie du prix, l’immense majorité ne se rendent pas vraiment compte de l’ampleur gigantesque des changements que cela va nécessiter, y compris dans leur vie quotidienne. Au fond, la plupart des écologistes démontrent par leurs choix de vie (plus précisément par l’absence de changements radicaux dans leur mode de vie) qu’ils partagent plus ou moins le fantasme d’une société « industrielle-mais-verte » : une société qui resterait essentiellement citadine et tertiaire, et où on continuerait à se déplacer, à se nourrir, à travailler, à se divertir, à se soigner, etc., à peu près comme aujourd’hui, mais de façon écologique, notamment grâce à la décarbonation (par exemple on se déplacerait en tramway plutôt qu’en voiture, mais pour aller faire à peu près le même travail).
Cela fait longtemps que je pense que cet horizon est un fantasme, qui a été parfaitement illustré il y a une dizaine d’années par le slogan de la Renault Zoé : « La voiture qui ne change rien à votre quotidien, et ça change tout. » Nous voudrions changer tout ET ne rien changer à nos habitudes, sauf à la marge et d’une manière qui nous permette d’avoir bonne conscience.
C’est pour cela qu’à, mon avis, le backlash écologique n’en est qu’à ses débuts : il se trouvera encore pendant longtemps une majorité d’occidentaux repus pour nier la gravité et l’urgence de la destruction de la biosphère, ou pour en faire porter la responsabilité aux zécolos qui ont retardé ou empêché la « modernisation industrielle », ou pour se palucher sur les solutions technologiques.
Après les prochaines électorales, un gouvernement RN – LR nous pend au nez. Les partisans du backlash s’en frottent déjà les mains, mais celles et ceux qui observent la destruction de la biosphère, qui se déploie comme une tragédie, n’ont pas fini de se désespérer.
L’article du Monde: « Le « backlash écologique » ou l’accélération brutale d’un mouvement réactionnaire profond«