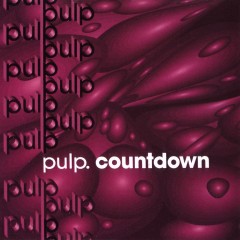Lorsque le groupe anglais de Sheffield a sorti son troisième album, « Separations », au milieu de l’année 1992, la pop du royaume de sa Majesté est éclipsée depuis plusieurs années par le grunge. On ne le sait pas encore, mais elle est à la veille de renaître de ses cendres avec Oasis, Blur, The Verve ou Suede… et ce disque de Pulp préfigure justement ce retour en grâce.
Les deux premiers albums de Pulp sont largement passés inaperçus, sauf auprès de quelques passionnés, notamment en France (Bernard Lenoir avait invité le grand dadais Jarvis Cocker et sa bande à une black session au début de la décennie). Mais avec « Separations », d’abord produit par un label tricolore(!), beaucoup d’amateurs de pop anglaise vont s’enthousiasmer pour ce groupe singulier et excitant, formé de quelques jeunes gens à la posture kitsch et savamment débraillée, dont l’univers musical était troublant, fourmillant d’obsessions sexuelles mais romantique à souhait, mélancolique et désabusé mais toujours élégant, dépressif mais dansant – bref à mille lieues des guitares rageuses de Nirvana. Personnellement, j’ai tout de suite adoré la façon dont Jarvis Cocker savait mettre en musique son désespoir, sur le mode de la confidence impudique, certes, mais tellement poignante, car j’y décelais un désir de reconnaissance et de compréhension à jamais inassouvi, et cela me parlait beaucoup, bien sûr. Il y avait quelque chose de cathartique et de rassurant à voir un autre que moi raconter ses obsessions et ses malheurs : je ne suis donc pas seul.
De cet album, j’ai déjà partagé « Don’t you want me anymore » , un morceau torturé et magistral dans lequel un garçon supplie la fille qu’il a larguée comme une malpropre de revenir vers lui, alors qu’elle est déjà « passée à autre chose », comme on dit.
D’abord sorti en face B d’un single en 1991, « Countdown » est très différent musicalement (plus linéaire, plus électro, plus rythmé et même carrément dansant. C’est un morceau de clubber sous acide (comme c’était alors la mode à « Madchester »), un morceau destiné à tout lâcher sur le dancefloor pour essayer d’oublier le stress et les angoisses du quotidien, mais il est néanmoins tout aussi impressionnant.
Jarvis Cocker raconte ici une autre histoire de loser, celle d’un type qui se repasse le film de ses dernières années et qui se désole d’avoir foiré, d’avoir laissé filer des opportunités. L’histoire commence à la fin de la puberté (« Oh I was seventeen, / when I heard the countdown start, it started slowly » ), au moment où il faut bien entrer dans l’âge adulte, cesser de se raconter des histoires et de se cacher, choisir une direction pour sa vie. Au moment où si on n’est pas très assuré de soi-même, ce qui était alors mon cas (et pas qu’un peu!), on en vient déjà à s’angoisser de ne pas faire les bons choix, d’avoir très vite beaucoup de choses à regretter, notamment de ne pas avoir été assez prêt pour affronter l’existence et pour profiter des gens et des expériences qu’elle aura placés sur sa route (« I think you came too soon » ). En 1994, Jarvis Cocker a lui-même détaillé cette interprétation dans une interview au magazine Record Collector : le compte à rebours dont parle « Countdown », c’est celui qui sépare chaque jeune personne du début de sa vie, et qui semble ne jamais devoir se conclure (« Waiting for your life to take off, and then realizing maybe the countdown’s never going to stop, you’ll never reach zero – and in the meantime, the rocket’s getting rusty and if it got to zero, it wouldn’t take off anyway. »)
Cette histoire profondément déprimante, Jarvis la raconte pendant plus de quatre minutes, sans pause, comme une sorte de flow disco. D’abord il parle plus qu’il ne chante, avec une nonchalance distante, mais petit à petit, au fur et à mesure que la musique devient plus intense et même frénétique, il s’emballe comme un cheval nerveux parti au galop, sa voix s’étrangle, et la chanson monte en puissance tant et si bien qu’elle devient carrément suffocante, jusqu’à une fin qui claque brutalement.
Comme l’a écrit Hugo Cassavetti dans Télérama, on finit la chanson « sur les genoux, aussi essoufflé que lui, mais heureux. » Je ne l’ai jamais écoutée en boîte de nuit (il faut dire que je n’y suis quasiment jamais allé de ma vie), mais j’imagine bien la scène, en effet.
« … but then I realised,
that this time it was for real there was no place to hide »