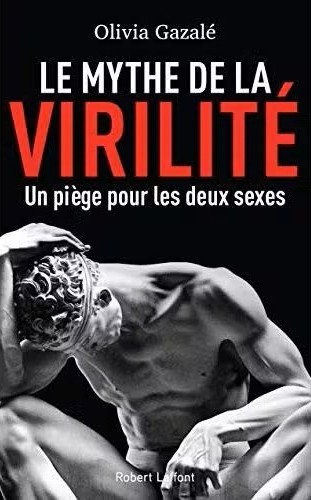« Boys don’t cry », c’est d’abord un album, que le journaliste musical Michka Assayas a décrit comme « le premier cri d’un groupe » , ou en tous cas d’un jeune homme, l’emblématique chanteur Robert Smith, qui exprime dès ce premier opus son mal-être persistant, ses inexpugnables sentiments de vacuité, de vanité et de solitude. Comme le dit encore Michka Assayas, les trois garçons chantent « leur effroi d’arriver dans un monde dans lequel ils avaient l’impression de ne pas exister, d’être transparents » (le titre de la superbe chanson « Three imaginary boys » décrit plutôt des spectres que des lutins joyeux).
Nous sommes alors en 1979, la vague punk est en train d’être concurrencée par ce qu’on appellera bientôt la new wave, puis par la synthpop et par la variété frétillante des années 80. Mais en attendant de s’ouvrir à son tour aux sonorités joyeuses de la pop avec le bonbon mentholé que sera « Friday I’m in love », The Cure raconte des histoires austères avec une musique au son minimaliste, squelettique, presque décharné, avec une production musicale à la lumière grise et blafarde (ce n’est pas pour rien qu’on parle alors de la cold wave).
« Boys Don’t Cry », c’est aussi une chanson, qui est très vite devenue l’une des plus emblématiques du groupe anglais, l’une des plus incontournables aussi – The Cure joue rarement un concert sans l’intégrer dans sa setlist. C’est aussi, dira Robert Smith dans une interview en 1992, l’une des cinq chansons qu’il préfère parmi toutes celles créées par son groupe.
Pour ma part je ne la classerais pas aussi haut (rien que sur ce disque, je préfère très largement « Three imaginary boys »). Mais je l’aime beaucoup quand même, et son titre et son thème n’y sont pas pour rien.
Je suis un garçon qui pleure facilement, beaucoup, souvent, et souvent très fort. Parfois à cause de terribles nouvelles, comme la mort de mes grands-parents. D’autres fois, c’est à cause de ruptures amoureuses très douloureuses, et qui le restent même très longtemps après. Il peut aussi m’arriver d’être soudain pris par un vif chagrin à l’idée que la solitude affective me pèse affreusement, ou par une immense fatigue face à l’ampleur de la tâche sur mon lieu. Parfois je fonds en larmes à propos de choses en apparence anodines, ou parce qu’une chanson fait remonter à ma conscience de vieux moments de détresse, ou parce que je m’identifie à des gens qui souffrent (pour peu qu’un film ou une série parle de façon émouvante de relations parents / enfants…)
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours été comme ça, immensément sensible et émotif, et j’ai toujours trouvé que l’injonction qui est faite aux garçons de ne pas pleurer parce qu’ils sont des garçons et parce qu’un garçon ça ne chiale pas comme une mauviette (une gonzesse), j’ai toujours trouvé, donc, que cette injonction est profondément débile et irrespectueuse. Aujourd’hui je sais en plus que c’est l’une des manifestations les plus évidentes et les plus pernicieuses du sexisme et du masculinisme, et même qu’elle en est un pilier fondamental, puisqu’elle contribue à dresser les petits garçons à se sentir supérieurs aux petites filles, elle leur apprend à manifester publiquement et ostensiblement cette prétendue supériorité et à mépriser celles (et ceux) qui sont incapables de « se maîtriser » ou de « se ressaisir ».
Quelle connerie.
//////
En écrivant cette chronique, j’ai repensé au beau livre que la philosophe Olivia Gazalé a intitulé Le mythe de la virilité, et je suis allé relire un article consacré aux larmes des hommes, dans lequel elle est abondamment citée.
On y apprend d’abord qu’il fut un temps où les hommes avaient non seulement le droit de pleurer, mais même que c’était pour eux un devoir. Dans « l’Iliade » par exemple, Achille sanglote souvent, tant et si bien que « la violence de ses pleurs fait partie intégrante de son héroïsme » . Mais comme le souligne Olivia Gazalé, il n’est pas pour autant question d’associer ces pleurs masculins aux « lamentations » des femmes. En effet, les larmes des hommes « manifestent une énergie virile » et noble, elles « s’inscrivent dans la piété, le deuil et le rapport aux dieux » , et surtout elles n’indiquent pas une attitude passive et soumise, mais au contraire une volonté déterminée de transformer la réalité. Il en va de même dans la Bible, où l’on peut par exemple lire que le prophète Jérémie « verse des torrents de larmes qui s’en vont grossir les fleuves de Babylone. »
Après la Renaissance, les hommes bourgeois n’hésitent pas non plus à laisser couler leurs larmes à l’occasion des représentations théâtrales, car c’est alors vécu, toujours selon Olivia Gazalé, comme « le signe d’une belle sensibilité » . Face à des situations émouvantes telles que la mise en scène de la souffrance du Christ, ne pas pleurer est une faute morale, l’aveu d’un cœur dur et incapable de compassion.
Mais dans la seconde moitié du XIXème siècle, « les larmes se découvrent un sexe » , et pour les hommes c’est « l’adieu aux larmes » . Depuis cette époque-là, pleurer devient pour un homme « une marque de lâcheté, de faiblesse et d’effémination » , ça les fait apparenter aux femmes qui s’attendrissent trop aisément et qui trahissent ainsi leur absence de raison, voire leur caractère hystérique. Depuis lors, dit Olivia Gazalé, « la rétention émotionnelle » est devenue « le pilier de la virilité » .
Dans ma génération, et plus encore dans celle qui m’a précédée, bien rares sont les hommes qui n’ont pas grandi en ressentant très fortement cette assignation à la virilité à travers l’interdiction de pleurer. Nos parents, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, les parents de nos copains, nous ont dit et redit de nous relever lorsqu’on tombe, de bomber le torse, de ne pas pleurer « comme des fillettes ». Comme le dit justement la docteure en littérature française Adélaïde Cron, ce n’est pas seulement que l’on refuse aux petits garçons de pleurer : bien plus, « On leur apprend à ne pas pleurer » . Dans le modèle patriarcal, « la rétention émotionnelle devient l’apanage du bonhomme » . Certes, un homme adulte peut pleurer de façon légitime, mais uniquement dans des circonstances bien définies, par exemple à l’occasion d’un enterrement (ce qui est alors une obligation sociale). Mais au quotidien, « l’homme qui pleure en public se condamne au ridicule » (Olivia Gazalé).
Ces réflexions sur les larmes des hommes décrivent une réalité très déplaisante, mais heureusement elles permettent aussi de tracer un chemin pour s’en extraire, et ce chemin est précisément celui de l’expression des émotions par les hommes, sans entrave ni honte, parce que même « si la domination masculine perdure, les larmes participent à la rendre moins toxique » . Un homme qui pleure n’est pas un homme qui fond (en larmes), qui éclate et se brise (en sanglots), et qui est donc menacé de perdre toute virilité, de voir sa façade sociale anéantie : c’est au contraire un homme qui s’exprime, qui se dévoile, et qui se commence à se reconstruire autrement. Comme le dit encore Olivia Gazalé, « Un homme sans émotions est un humain hémiplégique, enfermé dans la solitude de son cœur« , et la retenue des larmes est « une amputation d’une immense partie de [son] être » . L’autrice du Mythe de la virilité combat cela par un appel vivifiant : « Donnons aux garçons le droit de pleurer comme on a donné aux filles le droit de montrer leur courage et leur force!«
Je suis soulagé, immensément soulagé, de ressentir dans tout cela beaucoup de justesse et de bon sens.
//////
Pour en revenir à The Cure, je suis reconnaissant à ce groupe d’avoir ouvert la voie à une reconnaissance de la légitimité des larmes masculines.
« Boys don’t cry » sonne a priori comme une gentille bluette, avec un riff de guitare entraînant, des arpèges guillerets et une mélodie presque frivole. Mais à l’instar de ces bonbons acidulés qui sont d’abord sucrés et qui finissent pas piquer sous la langue (les fameuses « têtes brûlées »), la chanson laisse vite apparaître que l’histoire qu’elle raconte est cuisante. C’est de la fragilité de l’amour qu’il est question : un homme négligent ne s’est pas rendu compte qu’il était en train d’épuiser sa chérie (« Misjudged your limit / pushed you too far / Took you for granted / I thought that you needed me more » ), et elle a fini par se lasser et par le plaquer. Maintenant il a beau la supplier, il sent bien que ça ne servira à rien, car il a poussé le bouchon bien trop loin pour qu’elle revienne sur sa décision – alors il ne s’excuse même pas (« I would say I’m sorry / if I thought that it would change your mind / But I know that this time / I have said too much, been too unkind » ).
Maintenant cet homme n’a plus que les yeux pour pleurer… sauf qu’il est hanté par ce mantra maudit qui affirme que les garçons, ça ne pleure pas. Alors il essaye de tenir la face et de faire son malin, mais bien péniblement : « I try to laugh about it / cover it all up with lies / I try to laugh about it, / hiding the tears in my eyes / ‘Cause boys don’t cry » .
Ce texte est d’une ironie mordante, mais je l’ai toujours interprété comme étant l’aveu par Robert Smith d’une incapacité à retenir ses larmes, et peut-être que ça m’a aidé à apprendre moi-même à ne pas les retenir. Il est possible que je surestime le rôle que The Cure a joué dans ma vie. Mais peut-être pas. J’aime tellement ce groupe que je ne peux pas m’empêcher de croire que si je suis devenu un homme qui pleure facilement, c’est en partie grâce au courage émotionnel de Robert Smith (j’ai d’ailleurs commenté dans une autre chronique les larmes qu’il a versées en chantant « Endsong » en concert à Zagreb). Et cela me donne une raison supplémentaire de l’aimer, ce groupe. Je le sais : il sera pour moi l’un des plus importants, jusqu’au bout.