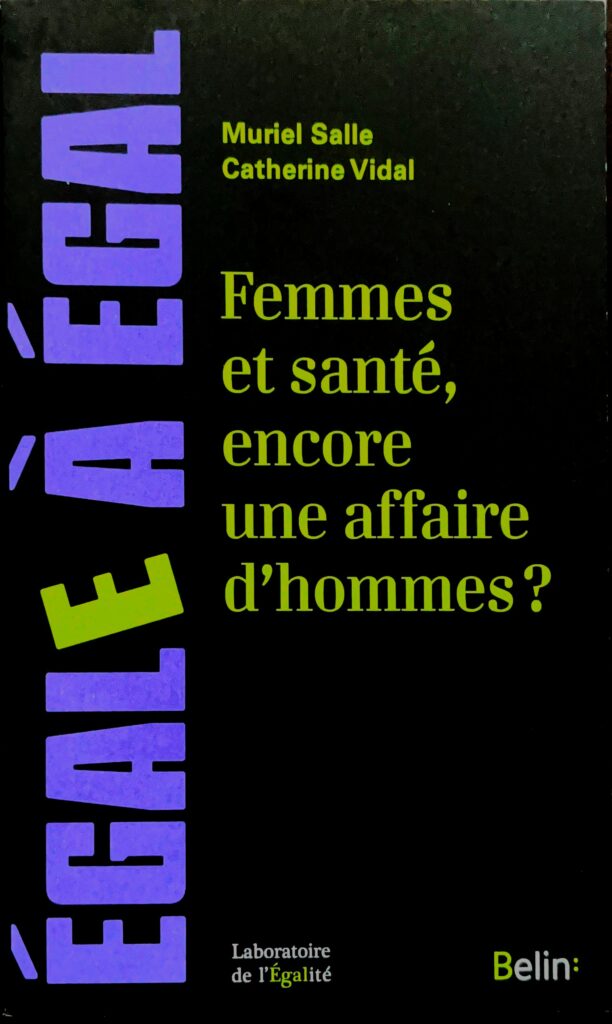La notion de « médecine bikini » désigne (et critique) « une approche médicale qui s’est construite autour de la norme du corps masculin, tout en ignorant les aspects spécifiques de la santé des femmes. » Historienne et maîtresse de conférence à l’Université Lyon 1, auteure de Femmes et santé, encore une affaire d’hommes (Belin, 2017), Muriel Salle explique très clairement les enjeux de cette notion en termes d’égalité hommes/femmes, dans une émission de France Inter dont le titre est éloquent : « Médecine bikini : les femmes, les grandes oubliées de la médecine ? »
La notion de « médecine bikini » a été inventée dans les années 1980 par une cardiologue américaine, Nanette Wenger. Cette formule signifie que si l’on excepte les travaux sur ce qui concerne l’appareil reproducteur des femmes et leur rôle de mère (la grossesse, l’allaitement), la médecine ne s’intéresse pas au fait que les femmes ont un métabolisme spécifique par rapport à celui des hommes, si bien qu’elles peuvent être atteintes de façon spécifique par certaines affections ou par certains accidents de santé, elles peuvent présenter des symptômes spécifiques, elles peuvent réagir aux traitements et aux médicaments de manière spécifique… Comme le dit Muriel Salle, la médecine fonctionne implicitement sur « l’hypothèse tacite que les femmes et les hommes réagissent de la même manière aux maladies et aux médicaments« . Sur la crise cardiaque, par exemple, « on vous décrit une symptomatologie spécifique de l’homme, et après, on se demande comment ça marche chez les femmes. On pense aux femmes en deuxième intention, sur le mode de l’exception, de l’atypique, comme en grammaire. »
En résumé, « les savoirs médicaux sont androcentrés, c’est-à-dire que le corps standard à partir duquel on construit la connaissance est un corps masculin. »
Or ce n’est pas du tout anecdotique, au contraire cela entraîne « des conséquences graves sur la santé des femmes » .
Par exemple, cela implique « un manque de sensibilisation, tant du corps médical que des patientes elles-mêmes, et un retard, par exemple, dans la prise en charge des infarctus féminins [parce que les symptômes de l’infarctus ne sont pas tout à fait les mêmes chez les femmes que chez les hommes]. Une erreur qui continue à coûter la vie à de nombreuses femmes » .
Autre problème causé par la « médecine bikini » : elle génère des outils de diagnostic inadaptés. Par exemple, les femmes consultent davantage que les hommes pour des troubles du sommeil, mais au final elles sont moins souvent diagnostiquées comme souffrant d’apnée du sommeil. Cela tient en partie au fait que « Les hommes s’arrêtent de respirer et les machines arrivent à le détecter, alors que les femmes, elles, ont une baisse importante de leur flux respiratoire, mais elles n’arrêtent pas complètement de respirer. Donc, elles passent en dessous des radars et on ne pose pas de diagnostic. Et sans diagnostic, on ne cherche pas de solution puisqu’on n’a pas de problème. » Résultat : on constate un sous-diagnostic de l’apnée du sommeil chez les femmes, et les femmes sont nettement plus nombreuses que les hommes à souffrir de ce problème sans qu’il soit pris en charge.
Muriel Salle reconnaît que « des progrès notables ont été réalisés en matière de prise en compte des femmes dans les essais cliniques, notamment en Europe. »
Mais elle alerte sur « les reculs récents observés aux États-Unis, où des mesures favorisant cette inclusion ont été supprimées. » « Depuis que le président Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, les lignes directives qui imposaient depuis 1993 la prise en compte des femmes et des minorités dans les essais cliniques ont disparu. » Avec déjà des effets concrets : Muriel Salle évoque ainsi une collègue en épidémiologie qui travaille sur la mortalité maternelle des femmes afro-américaines et qui a perdu tous ses fonds de recherche.
>> Le résultat est qu’aux États-Unis, les femmes sont d’ores et déjà moins bien soignées que les hommes, et que cet écart risque fort de s’accroître encore dans les prochaines années.
Pour finir, Muriel Salle insiste sur l’importance de sensibiliser les professionnel·es de santé à la nécessité d’une médecine « sexo-spécifique« .
//////
Je souligne : on parle ici de l’impact sur la santé du sexe, et non pas du genre auto-proclamé.
Certes, l’idéologie patriarcale est en cause dans le fait que les femmes sont moins bien soignées que les hommes, pour de nombreuses raisons qui tiennent aux stéréotypes de genre : la socialisation différenciée des hommes et des femmes amène les femmes à moins se plaindre que les hommes (ou à privilégier la santé de leurs enfants à la leur), la société a tendance à considérer que la vie et la santé d’un homme valent davantage que la vie et la santé d’une femme (et donc on dépense davantage pour soigner un homme qu’une femme, pour financer des recherche sur les affections exclusivement ou majoritairement masculines, etc.), on considère plus facilement que « c’est dans sa tête » quand il s’agit d’une femme, etc. Ce sont des constats bien documentés par la sociologie de la médecine, et ce sont des réalités qu’il faut combattre car elles sont à l’origine de discriminations scandaleuses vécues par les femmes.
Mais ce qui est en jeu dans la notion de médecine « sexo-spécifique », ce n’est pas le fait de « se sentir homme ou femme » ou de « s’identifier au masculin ou au féminin » : c’est d’abord le fait que biologiquement, les corps masculins et féminins diffèrent dans leur développement, dans leur réponse aux maladies et dans leur réponse aux traitements, et ils diffèrent en raison de différences qui sont d’abord, et de manière indépassable, biologiques. Un homme peut toujours prétendre que « la nature s’est trompée » (je ne vois pas bien ce que ça peut vouloir dire 🤔) et qu’en réalité il est une femme, il peut toujours exiger qu’on le considère comme une femme, il peut toujours recevoir l’approbation de son entourage et même obtenir un changement d’état-civil, ce n’est pas pour autant que son corps va se mettre à fonctionner comme celui d’une femme, sur le plan de l’infarctus, de l’AVC, de l’apnée du sommeil, ou de tout autre sujet médical (il ne se mettra pas à avoir un cycle menstruel et à avoir des douleurs de règles plusieurs jours par mois, il ne souffrira pas d’endométriose, etc.).
Je rappelle la formule de Muriel Salle déjà citée plus haut : si on néglige le fait que le corps des femmes fonctionne de façon spécifique et réagit de façon spécifique aux affections et aux traitements, alors cette méconnaissance ou ce déni entraînent « des conséquences graves sur la santé des femmes » . J’invite alors à se poser la question : si on prétend qu’une femme c’est « une personne qui se considère comme une femme » et donc que n’importe qui peut se revendiquer femme, est-ce qu’on ne contribue pas à cette méconnaissance et à ce déni, dont les premières victimes sont encore et toujours les femmes ?
[Henri Gervex, « Avant l’opération » , 1887, huile sur toile / Paris, Musée d’Orsay]